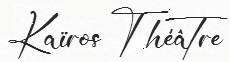Apoptose
ou la chute des feuilles en automne
Texte de Jeanne Mathis
Mise en scène & Scénographie Jeanne Mathis
Création son Djéké Koffi
Création Lumières Ivan Mathis
Avec Emmanuelle Paquet , Corinne Ruiz et la voix d'Ivan Mathis
Production déléguée Cie Kaïros Théâtre
Co-réalisation Scène Nationale Chateauvallon-Liberté d'Ollioules - Théâtre Denis d'Hyères
Subvention Le Conseil Général du Var
Il existe des domaines dans lesquels nos différences sociales ou culturelles, nos origines demeurent secondaires, des domaines qui nous réunissent pour un temps. Le deuil en fait partie, c’est un voyage universel et d’une certaine manière initiatique. Il nous renvoie à nous-même et aux autres, il dévoile ce lien intrinsèque qui nous relie car la perte d’un proche est une douleur partagée. Un lieu commun dans lequel nous pouvons apprendre à nous respecter, à nous pardonner, à accepter le désaccord.
Sur scène, deux femmes, figures évoquant une mère et sa fille. L’une est mourante mais sourit, l’autre redoute cet instant fatidique et se révolte.
Comment appréhender la maladie de nos proches ?
Comment se dire au revoir ?
Comment surmonter la perte et poursuivre sa vie ?
Que devient cet amour partagé lorsque l’autre n’est plus ?
Le mot apoptose du grec apoptosis qui signifie chute des feuilles en automne, désigne la mort cellulaire programmée, ou encore le suicide cellulaire.
Dans le sanctuaire du corps de la mère, la mort œuvre à créer la vie, elle sculpte l’être en devenir, procréant le vide nécessaire à la forme, modelant les doigts, creusant les conduits où circulera le sang, définissant le sexe, façonnant le cerveau. Une mort créatrice indispensable au développement de la vie. Cette mort ne se cantonne pas aux stades embryonnaires, elle nous accompagne tout au long de notre existence, renouvelant sans cesse nos cellules. Ainsi ce sentiment de pérennité de notre corps est illusoire, chaque jour, des parties de nous-même s’autodétruisent et se renouvellent et la peau de l’être aimé caressée la veille n’est jamais tout à fait la même au réveil. Nous sommes fait de cellules qui naissent et meurent en permanence, et d’autres qui nous accompagnent tout au long de notre existence. Nous sommes le fleuve en perpétuel mouvement.
Ce qui détermine la destruction d’une cellule, ce qui rend son suicide compréhensible, c’est le développement de l’individu dont elle fait partie. Ainsi l’apoptose est une abnégation de l’unité au profit d’un ensemble, la chute des feuilles à l’automne, permettant à l’arbre de survivre durant l’hiver. L’apoptose nous invite à regarder au-delà des limites de l’individu, au-delà du temps qui nous est imparti.
La transgression de cette règle – un désir cellulaire d’immortalité – conduit aux cancers dont la conséquence n’est autre que la mort d’un plus grand nombre, la mort de l’organisme dans son ensemble. Car les cellules qui nous dessinent et nous animent sont tributaires du mouvement de l’existence dans lequel toute chose est vouée à disparaitre. Et c’est un étrange paradoxe que d’espérer de nos cellules le sacrifice nécessaire à notre survie, lorsque notre instinct nous pousse à contrer cet instant inéluctable. Comment reprocher à l’unité qui nous constitue le refus de ce suicide lorsque nous même nous rêvons d’immortalité.
Apoptose ou la chute des feuilles à l’automne fait un parallèle entre les règles et les contraintes qui régissent les cellules et la relation de l’homme à sa condition éphémère.
Apoptose ou la chute des feuilles à l’automne traite de cette place intrinsèque de la mort au cœur du vivant. S’interroger sur notre capacité à voir au-delà des frontières, à s’inscrire dans le mouvement immuable de l’existence pour percevoir la mort non pas comme une fin, mais comme une promesse d’avenir, comme l’acte qui précède toute naissance.
PERSONNAGES
LA MERE.
LA FILLE.
MONSIEUR A
EXTRAIT – La tristesse
LA FILLE – Dis-moi, maman, comment te retrouver dans ce corps inconnu… corps boursouflé, et douloureux que tu ne contrôles plus… Dans quelle parcelle de peau, de boyaux subsistes-tu ? Tu es là… immobile… silencieuse… tu vis… tu vis de ton souffle régulier, de la circulation innée de ton sang, du battement de ton cœur… vie primitive, inaccessible à ceux qui t’aiment… vie qui s’est retranchée dans la solitude de l’être, s’étiolant à mesure que son monde s’immobilise… Dis-moi maman, subsiste-t-il dans ta sobriété vitale l’énergie nécessaire aux rêves, à la pensée constructive ? Tu es là… tu vis… Mais s’agit-il toujours de toi ? Dans cette dernière retraite qui est ta chair et où tu demeures à présent, solitaire, énigmatique, dans ce corps disloqué qui persiste à t’héberger reste-t-il un quelconque écho de nos rires complices, de nos colères pardonnées, de la trame immatérielle de nos souvenirs… de l’émotion et du partage ? Tu es là… immobile… silencieuse… tu vis… tu vis…
La fille se lève pour rejoindre un tas de vêtements en vrac. Elle commence à les plier pour les ranger dans des sacs poubelle.
LA FILLE – Tu sais, j’ai croisé ton médecin ce matin, pas le salaud, l’autre celui qui t’accompagne depuis le début. Je me suis rappelée son sourire devant les clichés de ton cerveau, clichés qui montraient le succès éphémère de la radiothérapie, tu te rappelles ? Cela fait plusieurs mois mais j’ai l’impression que c’était hier. Dis, tu te rappelles ?
Il avait fallu patienter longtemps dans la salle d’attente de l’hôpital, au milieu d’autres comme toi. Je ne pouvais pas m’empêcher de les observer, ces autres. Je percevais, – mais cela était-il réel ? – je percevais dans leur attitude une sorte de résignation instinctive… comme s’ils étaient frappés d’une condamnation irrévocable, comme s’ils savaient, malgré eux, que le téléphone ne sonnerait pas avant minuit. Peut-être, gardaient-ils en mémoire, depuis l’annonce de leur maladie, la victoire prochaine de leur mort, au-delà des rémissions ou de la guérison, au-delà de la vie. Et cette perspective loin de les accabler, semblait les rendre plus vivants, une pleine conscience du « plus jamais ». Plus jamais je ne pourrai prendre ma mère dans mes bras et sentir sa chaleur, son odeur… Je t’ai pris la main. Tu te rappelles ?
Tu feuilletais un des magazines posés sur la table basse, tu as été surprise. Dis tu te rappelles ?
Moi j’étais gênée, la pudeur familiale sans doute… J’ai dit une bêtise pour te faire rire, pour cacher mon angoisse d’un futur sans ta main à serrer dans la mienne. Je ne sais plus quelle bêtise… mais je me souviens de ton sourire. Un sourire qui n’était pas dupe, qui racontait la même résignation instinctive que les autres et j’ai songé : c’est ainsi que les condamnés peuvent poursuivre leur vie sans angoisse, dans la pleine jouissance de l’instant… Alors que tu me souriais, la psychologue est arrivée. Tu te rappelles ?
Elle avait l’air si accablé, avec sa voix indolente et son corps cotonneux. Dis, tu te rappelles ?
Je lui en ai voulu d’avoir interrompu ton sourire, de s’être immiscée entre toi et moi, d’avoir obtenu ton attention… quelques secondes de ton existence devenue si précieuse parce que brève, offertes à une inconnue... Après qu’elle fût partie je me suis moquée. J’ai dit qu’elle semblait moins innervée qu’une amibe… un trait de jalousie pour ces quelques secondes volées… Tu te rappelles ?
Je t’ai aussi charriée parce que tu avais accepté un rendez-vous. Dis, tu te rappelles ?
Tu m’as répondu : « La pauvre, elle ne doit pas avoir beaucoup de patients qui prennent le temps de lui parler, regarde comme elle a l’air dépressive, je peux bien lui offrir cela. » J’ai ri, de ta générosité, de ton souci des autres, de ta désinvolture devant le pronostic alarmant de ta tumeur maligne non opérable…
[...]
LA FILLE – Les mamans nous promettent de doux rêves le soir venu et nous nous endormons le sourire aux lèvres, croyant aux licornes, aux contes de fées, aux fins heureuses de nos livres illustrés et quand survient le cauchemar de leur mort, nous restons là, hébétés, incapables de nous réveiller. Les mamans soignent nos genoux écorchés mais demeurent impuissantes à nous relever du gouffre qu’est leur décès. Elles nous apprennent à marcher, à parler, à gribouiller sur des feuilles de papier brouillon de jolies maisons colorées… et leur maladie, leur sénilité, leur disparition, est une ultime leçon. Une leçon qu’il nous faut rabâcher malgré notre désaccord, jusqu’à en admettre l’inéluctable constat… Tu vois maman, j’apprends, tous les jours j’apprends à t’oublier, à ne garder de toi que des instants fugaces de souvenirs heureux… Mais ce n’est pas si facile. Par moment la bête, ma bête, se met à frémir. Tapie dans un recoin de mon esprit, la bestiole attend les moments propices où je baisse la garde pour mordre à pleine dents. Blessure à vif de l’absence qui s’emploie avec brio à déclencher l’ignoble douleur, les sanglots, la morve…
Quel paradoxe perfide, n’est-ce pas ? Cette inévitable dépendance entre amour et souffrance…
Le prix à payer pour donner une quelconque valeur à la perte, pour t’avoir comptée parmi les essentiels à ma vie…
MONSIEUR A. – Nous sommes la conséquence d’interactions entre atomes et les atomes sont des parcelles de vide ponctuées de particules, nous sommes du vide serti de matière. Or, à l’échelle microscopique, le vide n’est pas l’absence de toute chose. Il est cette vibration qui subsiste au-delà de la matière et du verbe, au-delà du souvenir. Une condition singulière où l’énergie persiste dans sa forme la plus infime. Onde oscillante hors du temps et de l’histoire.
Peut-on envisager l’état de mort comme cette oscillation pérenne où l’énergie palpite dans l’attente d’un renouveau ? Et si oui, cette même énergie peut-elle concilier le détachement de l’infini avec l’attachement d’une vie ? Et si oui, qu’emportons-nous dans ce lieu en devenir ?
L'acceptation
Le déni
Le choc
Colère & marchandage